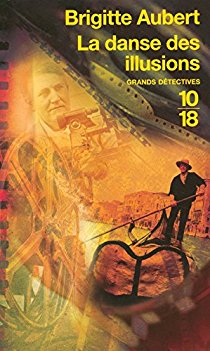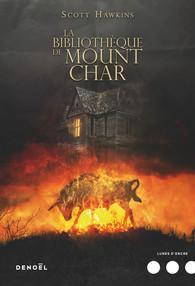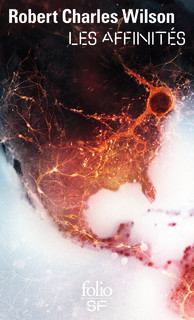« Chefs d’œuvre du fantastique, de E. T. A. Hoffmann à Stephen King », réunis par Jacques Goimard
Il semblerait qu’un membre de ma famille proche me trouve léger sur les références aux Grands Anciens dans ces biftons d’humeur. Il n’a pas tort mais je ne suis ni exégète, ni critique, ni chroniqueur et, surtout, mes neurones mémoriels sont presque tous cramés. Bref, je me retrouve à lire du « classique », en tout cas sur les auteurs retenus, parce que les textes…
Je n’ai lu qu’un bout, dans l’ordre (336/1121)) choisi puisqu’il n’a rien de chronologique et mélange les auteurs de différents siècles. Faut laisser un blanc entre chaque nouvelle.
On commence par une préface que je n’ai pas finie pour définir le fantastique, et on l’oublie.
Achim von Arnin est un rien ennuyeux dans son « Melük Marie Blainville ». Le « Viy » de Gogol est étonnant à plus d’un titre, surtout sur les mœurs des étudiants ukrainiens dans cette histoire reprise du folklore. Dans ces deux textes s’éveille la sorcière, belle et méchante.
Le texte de William W. Jacobs, « la Patte de singe » aurait pu rester inconnu de moi. « Peter Brugg a disparu » de William Austin est assez original sans avoir ni queue ni tête (de diable, bien sûr).
« Le jeune maître Brown » de Nathaniel Hawthorne est d’un niveau au-dessus, avec de l’humour (que j’espère volontaire) sur le satanisme dans les villages.
Maintenant, deux pépites qualifiables de chefs d’œuvre, « La Faux » de Ray Bradbury et « Marée basse » de Jacques Sternberg, sur la mort. Sans doute très connues, je ne me souvenais pas les avoir lues.
Charles Dickens a écrit du fantastique (Ah bon ? me dis-je, ignare que je suis) mais « le Signaleur » ne m’a pas paru terrible du tout, et mal construit. Mais qui suis-je pour oser dire sur un maestro incontourné ?
« Celui qui se faisait appeler Schaeffer » de Yves et Ada Rémy ne m’a pas enthousiasmé, ni « La bête à cinq doigts » de William Harvey.
Et voilà Edgar Poe avec « La chute de la Maison Husher », dont personne, même pas Bademoude, n’osera contester la présence dans un bouquin avec un titre pareil.
« La morte amoureuse » de Théophile Gauthier est un peu trop emberlificotée dans un vocabulaire recherché pour que j’éprouve du plaisir à sa lecture. Dommage.
Quant à « Le Chupador », ce n’est pas du tout le Claude Seignolle dont j’avais souvenance: sorcellerie et campagne, simplicité et fantastique. Non, c’est un texte hyper travaillé (à en devenir pénible) sur une forme impossible (même dans un texte fantastique) de vampirisme.
Je m’arrête là. Chefs d’œuvre ? Il y en a mais de nombreux textes n’on pas emporté mon adhésion. C’est comme ça. Je suis pénible, je sais.